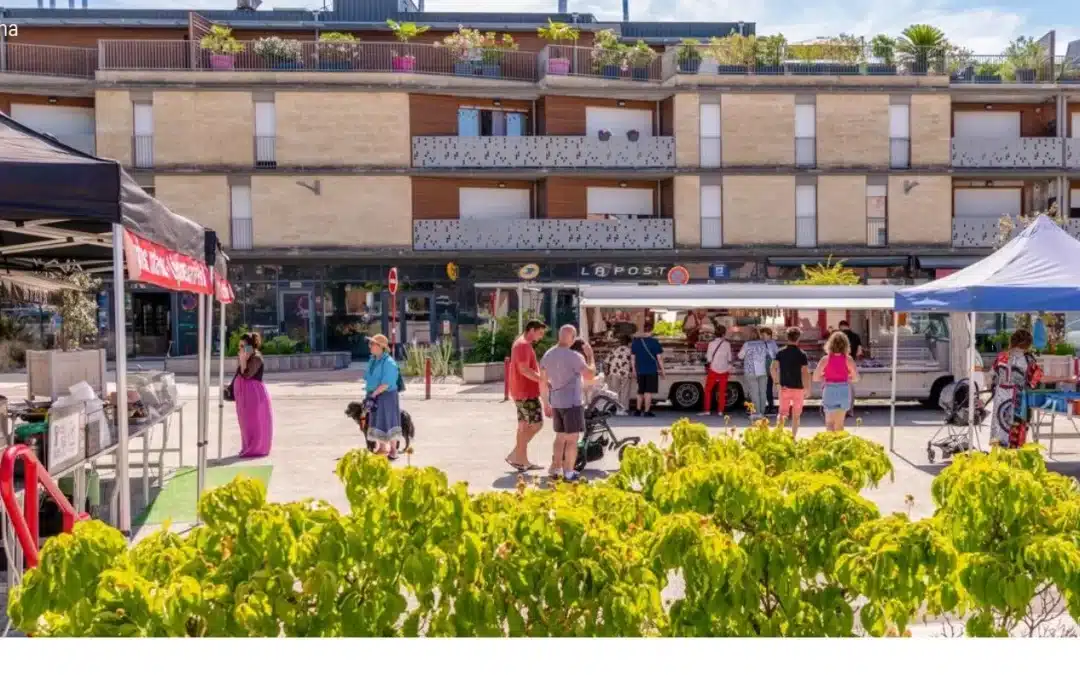Le « facteur humain » ? Nos biais comportementaux ? Les injonctions à changer nos comportements se multiplient depuis longtemps, nous sommes nombreux à « faire pipi sous la douche », les nudges s’occupent même des plus récalcitrants. Certes, chacun doit « faire sa part » et le succès des colibris selon lesquels « chacune et chacun détient une part de la solution » a participé à mettre le sujet sur la table. Et pourtant… quelque chose manque toujours et « résiste ». Pire encore, ces injonctions individuelles pourraient bien s’avérer contre-productives. C’est là, une leçon majeure à retenir des sciences sociales : au-delà de l’individuel, il existe des biais collectifs majeurs. Ils sont énormes, et nous les négligeons trop souvent.
La part collective des choix individuels
À cet égard, le travail des sociologues, comme Sophie Dubuisson-Quellier, directrice de recherche au CNRS (et présidente du conseil scientifique de l’ADEME), est éloquent. Le podcast Chaleur Humaine, tristement bien nommé en cet nouvelle année de canicule et de méga-feu, s’en fait les échos dans un épisode d’interview hautement intéressant et didactique. La chercheuse explique que « la sociologie nous apprend que ce qui relève des comportements individuels est inscrit dans des dimensions très collectives [qui] ont un poids tel que cela contraint ou oriente les décisions individuelles ». Elle prend un exemple simple : le choix d’une chaudière. Il relève certes pour une part d’une décision individuelle, réfléchie et responsable, mais il est aussi fortement contraint par le matériel déjà là. Et c’est sans compter les dimensions contractuelles et marchandes du fournisseur d’énergie lui-même encastré dans un marché plus ou moins régulé par les politiques publiques. Elle insiste en pointant qu’une « grosse partie de ce qui est pensé comme des choix individuels relève de l’organisation collective ». Pour elle, la « complexité de la société est à investir à partir des sciences sociales » puisque « cette crise climatique c’est une crise sociale, c’est une crise de nos organisations sociales ». Pour la résoudre, il faut se pencher d’urgence sur ces mécanismes sociaux, organisationnels, institutionnels pour identifier les verrous et leviers associés. On ne peut espérer enclencher les transformations nécessaires qu’en comprenant comment fonctionne la société, à l’appui des sciences sociales.
Refonder un nouveau contrat social
Sur la sobriété, la chercheuse cible un paramètre : l’abondance. Cette dernière fonde selon elle le système de valeur à la racine de notre société actuelle. Tout est fait pour consommer en abondance, renouveler nos produits et acheter toujours plus : la croissance est sous perfusion, en totale contradiction avec l’injonction à la sobriété. À tel point que ces injonctions contradictoires, entre messages individualisants et mécanismes poussant à consommer, éloignent les individus des comportements écologiques. Pour modifier ce fonctionnement si global, elle propose de bâtir un nouveau « contrat social ». Rousseau n’a qu’à bien se tenir. Précisément, elle détaille qu’il faut créer (et nous y voyons déjà quelques pistes à promouvoir) :
- de nouvelles politiques publiques (cela fait penser aux propositions de la convention sur le climat sur la limitation de la vitesse autoroutière, ou aux villes en avance sur la sobriété numérique ou publicitaire)
- de nouveaux modèles d’affaires (les nouveaux modèles de services urbains, esquissés par N. Rio, I. Baraud-Serfaty, H. Delhay et C. Fourny nous paraissent un bon exemple)
- de nouveaux régimes de valeur (on s’y essaye en travaillant sur les imaginaires et les récits, par exemple sur les modes de vie en 2050 avec l’ADEME)
- de nouveaux indicateurs de « prospérité » (certains scientifiques proposent de nouveaux indicateurs autour de cette notion pour se passer du « développement » ou de la « croissance »)
Beau défi en perspective !
Vices et vertus de l’approche individuelle
Il y a un paradoxe : les baromètres montrent que la majeure partie des individus a conscience de l’urgence à agir (par exemple celui de l’ADEME) , et pourtant on constate que l’action humaine peine à suivre. Quoi de plus normal que de cadrer l’action sur l’individu, ses comportements et biais psychologiques pour résoudre ce paradoxe ? Qui dit sociologue, dit approche critique. Et c’est aussi pour cela qu’ils sont forts utiles : ils nous fournissent du poil à gratter pour sortir de nos cadres. Dans un autre livre, Le biais comportementaliste, co-écrit avec des collègues en 2019 (pour les plus pressés, une recension est disponible ici), plusieurs chercheurs passent au grill une approche comportementaliste qui a envahi les politiques publiques, et son incarnation pratique, le nudge. Théorisé par l’économie comportementale américaine, ces dispositifs matériels poussent les usagers à un comportement sans qu’ils ne s’en rendent compte en traitant leur biais cognitif : la cible au fond des toilettes, les légumes verts placés en avant dans les cantines, ou les options cochées par défaut dans les formulaires. On peut admettre avec les auteurs que faire agir l’individu de manière quasi-mécanique – sans qu’il en ait conscience et sans questionner ses préférences – dans le sens décidé par les concepteurs du dispositif pose question sur l’ambition démocratique, voire sur la manipulation à l’œuvre. Qui voudrait d’une société de citoyens mécaniquement formatés à agir pour le bien commun ? Ils regrettent ainsi qu’une telle approche individualisante soit devenue hégémonique dans nos instruments d’action publique, et pas seulement au sujet de la sobriété (aussi concernant les impôts, la santé publique, etc.). Ils questionnent leur efficacité face au manque d’études évaluatives : les comportements ciblés importent-ils vraiment (faible impact face à la sobriété par exemple), et si on ne touche pas aux déterminants sociaux structurels, les individus ne vont-ils pas reprendre leurs mauvaises habitudes au bout d’un moment ?
Et pourtant, à y regarder deux fois, tout n’est peut-être pas à jeter dans les nudges et l’approche individuelle, comme le suggère l’animateur du podcast Chaleur Humaine en conclusion. C’est aussi ce que nous avons constaté à Auxilia, à travers notre accompagnement du changement. Par exemple, nous avons expérimenté des nudges pour favoriser le report modal vers la marche en Vendée pour le compte de la DREAL Pays de la Loire.
Le fait d’enclencher un premier passage à l’acte et d’expérimenter nous parait un levier majeur : on projette beaucoup sur une pratique et sa difficulté, alors qu’il arrive souvent qu’on se rende compte que « l’essayer c’est l’adopter » ! Par exemple, en se rendant compte qu’un barbecue végétarien ce n’est pas si frustrant ou que le trajet à vélo jusqu’à la gare n’est pas si fatiguant. En poussant à agir, le nudge peut ainsi participer à sensibiliser, éveiller les consciences et surtout expérimenter de nouvelles manières de faire. Par contre, il parait indispensable de l’assortir d’une forme de réflexivité, c’est-à-dire un retour sur le vécu pour prendre conscience de ce qu’implique la nouvelle pratique, et pour réfléchir collectivement à un changement plus global (voir l’exemple du travail par Wimoov auprès des plus précaires pour les accompagner à être mobile, en dehors de la voiture).
Il ne faut pas non plus négliger l’effet collectif des comportements individuels : voir les autres agir et donner l’exemple fait réfléchir les autres. Jouer sur l’instinct grégaire est utile pour renforcer la désirabilité des modes de vie sobres. De même, auprès des commanditaires (les collectivités typiquement), répondre à leur demande centrée sur l’individu est une bonne porte d’entrée pour discuter du collectif et sensibiliser aux freins organisationnels. Quoiqu’il en soit, si ces dispositifs sont un premier pas, ce n’est pas seulement avec des nudges, et surtout sans le collectif, qu’on fera aboutir la redirection écologique.
Pourquoi nous négligeons les biais collectifs ?
Le constat de l’oblitération des dimensions collectives est finalement assez étonnant : la sociologie et les sciences sociales ne sont pas des disciplines récentes et cela fait longtemps qu’elles pointent ce genre de freins. Quels sont les biais qui font qu’on ne voit que les biais individuels ? Tout d’abord, il faudrait chausser les bonnes lunettes. Force est de constater que les informations globales qui nous parviennent sur l’état de la société se focalisent souvent sur l’individu. Les baromètres et autres enquêtes parlent souvent de l’avis des français, leurs perceptions, de leurs manières de vivre ou de leurs habitudes : c’est plus vendeur car chacun s’identifie. Mais Becoming urban cyclistsforcément, à ne regarder que les individus, on focalise les actions possibles sur lui. Pour s’en extraire, il faudrait prendre le temps de lire des enquêtes qualitatives, comprendre les processus, suivre des approches biographiques ou ethnographiques, plus institutionnelles et organisationnelles. La littérature en sciences sociales est riche de telles analyses (par exemple les ouvrages collectifs Becoming Urban Cyclists: From Socialization to Skills ou Repenser la transition énergétique, un défi pour les sciences humaines et sociales reflètent un éventail de questions dépassant largement l’approche individuelle). Malheureusement, le filtre médiatique leur laisse peu de place. Cela permettrait pourtant de dépasser ce prêt-à-penser et la force des chiffres simplificateurs pour saisir l’épaisseur qualitative des complexités sociales, dont le décryptage est si indispensable pour agir.
Ensuite, il faudrait conduire ces études en amont des politiques publiques pour bien comprendre les comportements et leurs déterminants sociaux, économiques et politiques. Cela reviendrait par exemple à distinguer certains publics et à conduire des actions différenciées (il n’y a pas un « usager » homogène, associé à un comportement mais des situations individuelles diverses reliées à des contextes sociaux). A ce titre l’IDDRI fournit un exemple éclairant :
Une façon classique d’aborder la décarbonation du secteur du bâtiment est [d’agir sur] les solutions techniques et les politiques associées, et de s’interroger en aval sur la dimension comportementale résultante du scénario technique – par exemple, comment faire en sorte que la population respecte une certaine température de chauffage ? –, question qui ne trouve en général pas de réponse satisfaisante. Une autre façon de faire serait d’intégrer plus en amont dans le raisonnement des éléments comme : l’adéquation entre le parc de logements et la structure des ménages ; les différentes représentations du confort thermique ; les diversités de situation sociale dans son logement, dont la précarité énergétique ; les contraintes dans l’organisation du marché du logement et les politiques publiques associées, etc., afin de nourrir la définition des possibles techniques et politiques.
Or souvent, les collectivités et commanditaires ont besoin d’agir vite : pour répondre à l’opportunité d’un appel à projets ou parce que les calendriers électoraux sont contraints et qu’il faut pouvoir démontrer qu’une action concrète est conduite pour légitimer les équipes en place. C’est ce que la sociologie de l’action publique appelle la « légitimation par les outputs » : on s’attache davantage au résultat (visible, quantifié) d’une action publique qu’à son processus (sa qualité, ses participants, sa procédure de décision).
Par ailleurs, centrer sur l’individu c’est éviter de remettre en cause des normes structurantes, des institutions stables et des hiérarchies sociales établies. Un autre verrou collectif, commun à beaucoup de situations, est donc celui de l’évitement du débat, et in fine l’évitement du politique. D’une part, le système électif rend difficile pour un élu d’assumer s’être trompé (le risque électoral est fort) et d’autre part les organisations professionnelles laissent peu de place pour une remise en cause de ses propres compétences (quel consultant serait capable de dire s’être trompé face à un client ? Ou regardez LinkedIn où tout un chacun n’affiche que ses réussites). Y remédier nécessiterait d’instituer un droit à l’erreur. Pire encore, les verrous collectifs peuvent être liés à d’autres organisations, voire à l’État, et cela reviendrait à questionner ces institutions et à dépasser le champ de compétence qui nous est attribué.
Enfin, se concentrer sur l’individu et ses biais, c’est se concentrer sur des moyens plutôt que sur les finalités attendues. C’est choisir un outil plutôt qu’interroger le modèle de société sous-tendu par l’instrument : veut-on des citoyens éclairés et instruits ou une élite qui produit des outils pour diriger les foules ? Trop souvent les outils sont porteurs de finalités qui dépassent ceux qui les utilisent et sont trop peu questionnées. Alors si notre vrai biais individuel, c’était surtout d’oublier nos encastrements collectifs ?
Renouveler notre fonction de conseil
Notre métier, c’est d’accompagner des clients, institutions ou collectivités, vers une transition écologique ambitieuse. Si les cahiers des charges parlent toujours et avant tout de sensibilisation des individus et d’acceptabilité sociale de pratiques par les individus, on voit poindre de nouvelles demandes un peu plus ouvertes qui visent à changer les encastrements collectifs. Ainsi, à Corcoué-sur-Logne (44), nous expérimentons une démarche d’implication citoyenne très large au-delà de l’acceptabilité individuelle. De même, pour l’ADEME, nous avons travaillé sur les modes de vie en 2050. Ces nouvelles questions nous interrogent sur la meilleure manière d’accompagner nos clients vers la redirection écologique. Plusieurs pistes tirent parti de nos expertises en sociologiTweet Chloé Ridele :
- Travailler sur la désirabilité : parler « d’acceptabilité » de mesures de sobriété devrait être un signe que la prise en compte des enjeux collectifs et sociaux est trop tardive comme le souligne l’ADEME. Avant de parler d’acceptabilité, il convient notamment de travailler sur la désirabilité d’une société de la sobriété. Cela passe par la production d’imaginaires, le partage d’expériences désirables et l’échange de bonnes pratiques. Et surtout par l’évitement de messages contradictoires : quoi de pire qu’un ministre qui va voter en jet privé quand il incite à la réduction de nos consommations fossiles ? Ou le clip d’un célèbre footballeur fléché par Chloé Ridel ?
- Mettre à jour et établir une cartographie des enjeux sociaux du changement, en identifiant les interdépendances sociotechniques, c’est-à-dire le lien entre le territoire et la société humaine. Les territoires ne sont pas seulement une somme d’individus vivant sur un territoire physique : le rapport entre les humains et le territoire passe par un enchevêtrement de collectifs, d’organisations et d’institutions qui organisent les pratiques sociales et doivent également se transformer.
- Équiper la décision : les enjeux sociaux sont souvent le parent pauvre des décisions. S’il existe parfois des décisions « gagnant-gagnant », la majorité des mesures à prendre face à l’urgence climatique impliquent des renoncements qui peuvent priver des groupes sociaux (ou être vus comme tels en fonction des représentations). Les sciences sociales permettent de mesurer les inégalités potentielles pour trouver les moyens de la justice sociale (recherche d’équité, mesures compensatoires). Concrètement, on peut mettre au point de nouveaux indicateurs ou de nouveaux outils de gestion qui permettent de transformer l’organisation qui porte ses actions, d’appuyer l’action des professionnels, comme la comptabilité verte (les sciences sociales montrent bien comment les outils de gestion formatent une vision du monde et verrouillent le champ des pratiques possibles associées, cf. Sociologie des outils de gestion de E. Chiapello et P. Gilbert).
- Opérationnaliser la décision par la levée des biais organisationnels : les structures sociales induisent des freins : dépendance au sentier, rapports de pouvoir implicites, décisions absurdes, cercles vicieux bureaucratiques, routines professionnelles, cloisonnement de la division du travail, outils de gestion unidimensionnels, circuits de décision peu clairs, notions floues peu opérantes, etc. L’analyse socio-organisationnelle permet d’opérationnaliser le changement en identifiant ces biais pour mieux les accompagner.
- Cibler les « entrepreneurs de changements » : le podcast le souligne bien, des collectifs sociologiquement spécifiques (par exemple des étudiants de grandes écoles qui s’offrent des tribunes à leur remise de diplôme), font office de modèle et participent à faire circuler des « trucs et astuces » de changement (consommation ou job engagé, etc.). Pour qu’ils essaiment et aient un impact collectif structurant, il faut qu’ils soient au cœur (comme ces étudiants d’institutions réputées) et non plus seulement à la marge. À nous d’être attentifs aux pratiques de la marge porteurs d’innovations (par exemple l’engagement associatif, les pratiques de débrouilles, les manifestations ou les luttes environnementales) et de les mettre au cœur de nos politiques publiques et en faire des leviers de changement institutionnel.
Quand écologie rime avec social : une redirection inclusive
Et si finalement c’était aussi une question de posture ? Quand on conseille des institutions publiques, c’est notre devoir d’avoir en tête que la politique se niche dans nos outils d’actions. Nous devons mettre à jour les choix implicites et les modèles sous-jacents, faire réfléchir et sortir des cadres, et devenir des véritables « sparring partners » de l’ingénierie publique en développant la réflexivité sur nos pratiques et nos préconisations pour déceler ces fameux « biais collectifs ». Nous devons également accompagner en toute humilité : ne pas prendre les citoyens lambda pour des idiots et faire confiance à leur capacité de discernement. L’étude « modes de vie 2050 » montre bien qu’en y réfléchissant, les citoyens sont favorables à des actions politiques fortes pour réguler les marchés et les pratiques des ménages comme des entreprises. La convention citoyenne a d’ailleurs préconisé la réduction de la vitesse autoroutière alors même que c’est une mesure spontanément rejetée.
Enfin, l’approche par les sciences sociales permet de dépasser le contexte de la décision individuelle pour jouer sur les déterminants structurels des pratiques sociales. De la sorte, elle permet l’inclusion sociale en ne laissant pas sur le bord de la route ceux dont les pratiques sont contraintes, par exemple par des choix économiques ou des normes sociales (les nudges ne sont efficaces à long terme que sur les comportements de ceux qui ont véritablement le choix du changement !). Et surtout, elle évite d’être contreproductive : à force d’injonction à la sobriété individualisante et de matraquage médiatique sur un modèle consumériste, comment ne pas comprendre la lassitude et le ras-le-bol d’une partie des citoyens qui se désinvestissent de ces questions ?
Bibliographie pour aller plus loin :
- Bon pote – 10 idees recues sur la sobriete des modes de vie
- Bergeron, H., Castel, P., Dubuisson-Quellier, S., Lazarus, J., Nouguez, É., Pilmis, O. (2018). Le biais comportementaliste. Presses de Sciences Po. Pour les plus pressés, une recension est à lire ici.
- Podcast Chaleur Humaine : « Climat : peut-on sauver la planère avec des petits gestes »
- Podcast IDDRI « La sobriété, de l’individuel au collectif »
- Dubuisson-Quellier, S. (2008). De la souveraineté à la gouvernance des consommateurs : l’espace du choix dans la consommation. L’Économie politique, 39, 21-31.
Crédits photo : Photo 1 / © Orbon Alija