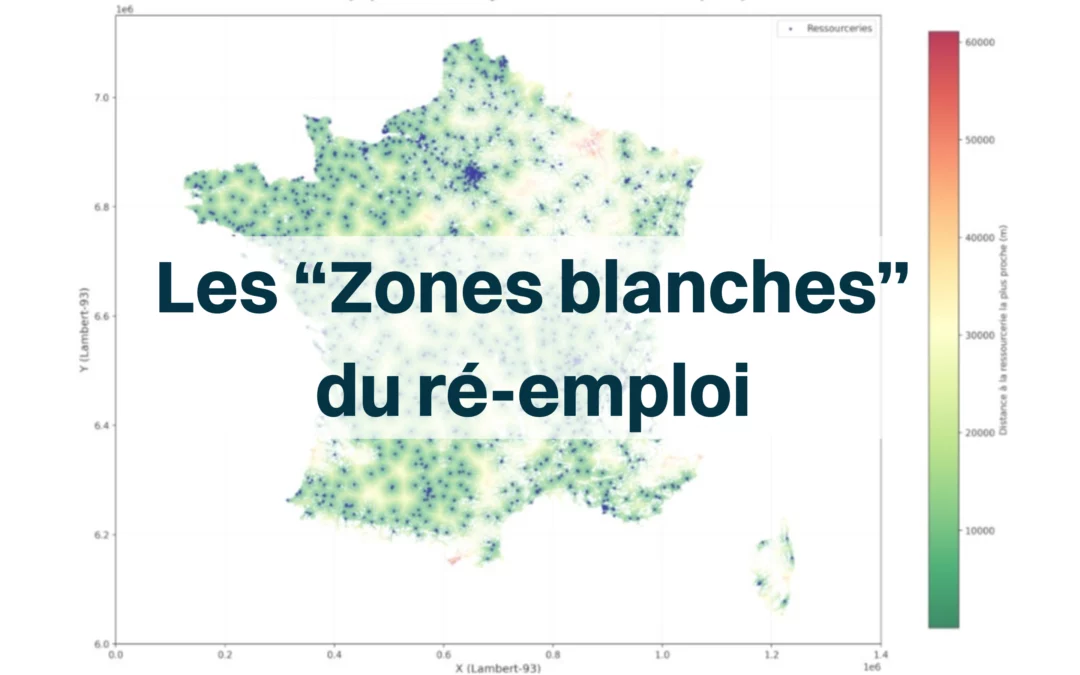Nous nous souviendrons de l’été 2025 comme celui où nos député.es ont failli voter un moratoire sur le solaire et l’éolien. Heureusement, l’Assemblée nationale s’est mobilisée le 24 juin pour rejeter cette proposition et ainsi rappeler l’utilité sociale des énergies renouvelables (EnR) pour notre pays, et éviter un revirement que certains ont tenté d’imposer. Un vacillement qui a cependant plongé la filière tout entière dans l’incertitude durant ces dernières semaines. Mais alors, comment en sommes-nous arrivé.es là ? Et surtout comment restaurer la confiance envers ces filières ? Chez Auxilia, nous sommes convaincu.es qu’il y a urgence à poursuivre l’écriture du récit national autour des énergies renouvelables, et donc à démontrer la valeur qu’elles génèrent partout dans les territoires.
Les filières renouvelables : l’adhésion est-elle toujours aussi forte qu’avant ?
Alors qu’en 2022 le pays se préparait à d’éventuelles coupures de courant en raison de la défaillance du parc nucléaire et de la flambée des prix de l’énergie, le soutien aux énergies renouvelables était une évidence. Malgré ces certitudes, ces derniers mois, le récit national a pris la tangente, notamment à la suite de deux faits majeurs.
Le premier, c’est le black-out du réseau électrique ibérique survenu en avril dernier, où tout le monde s’est empressé d’accuser les énergies renouvelables sans même attendre les conclusions de l’enquête gouvernementale espagnole. Depuis, le rapport publié en juin dernier a révélé que cette coupure généralisée était liée à une réaction en chaîne d’événements qui ne mettaient pas spécifiquement en cause les EnR : des épisodes de surtension, des oscillations, des déconnexions de centrales électriques et des erreurs de configuration des mesures de sécurité.
Le second, c’est l’excédent actuel de production sur les marchés de l’électricité qui augmente l’occurrence de prix négatifs et génère une perte financière importante pour les acteurs de l’énergie. Beaucoup attribuent ce surplus d’électricité aux énergies renouvelables, sans vision d’ensemble ni regard critique sur la rigidité du mix français actuel. En effet, cet excédent de production est dû à un phénomène multifactoriel : un retard important dans l’électrification des usages en France, un système nucléaire peu modulable, une volatilité des prix importante, etc.
Il n’en fallait pas plus pour débattre à nouveau du développement des énergies renouvelables. Un débat qui s’inscrit dans la durée, alors même que l’étude produite en mai dernier par l’IFOP nous rappelle que 84 % des Français.es ont une image positive des énergies renouvelables et que, par ailleurs, nous sommes le seul pays de l’Union européenne à ne pas avoir atteint nos objectifs de production d’énergies renouvelables (1). En 2024, 60 % de l’énergie consommée en France provenait encore des énergies fossiles (source : RTE).
Pourquoi un tel retard sur le déploiement des filières d’EnR en France ?

La PPE établit ainsi les priorités d’action de l’Etat en matière d’énergie pour la France hexagonale dans les 10 années à venir, partagée en deux périodes de 5 ans ainsi actualisée. Cependant, la PPE 3 couvrant la période 2025-2035, qui aurait dû être adoptée il y a plus d’un an, est toujours en discussion. De report en report, les politiques débattent du mix énergétique, à coups de décrets et d’amendements. Les désaccords portent en partie sur la répartition entre nucléaire et énergies renouvelables, avec des inquiétudes quant à la stabilité du réseau électrique et des finances publiques. Néanmoins, dans la période de tension actuelle, celle-ci est largement attendue par l’ensemble des acteurs de la filière EnR, afin de sécuriser les investissements et de garantir notre souveraineté énergétique sur le long terme.
Ces inquiétudes soulevées par les EnR quant à la stabilité du réseau électrique sont-elles justifiées ?
Pour comprendre les craintes qui pèsent sur la stabilité du réseau, il faut savoir qu’historiquement, le réseau électrique français a été conçu de manière centralisée et descendante. Les centrales nucléaires, thermiques ou renouvelables de grande puissance produisent de l’électricité qui est injectée sur le réseau de transport RTE (HTB), puis distribuée sur le réseau de distribution Enedis (HTA et BT) vers les différents points de consommation.
Imaginez maintenant l’inverse, des milliers de foyers qui produisent de l’énergie à l’aide de panneaux solaires, qui consomment leur production et qui injectent leur surplus sur le réseau de distribution. Le réseau n’ayant pas été initialement dimensionné pour recevoir des charges diffuses, il est mis en tension techniquement. Néanmoins, au-delà de la modernisation du réseau, il existe de nombreux leviers à l’étude pour réguler ces fluctuations et absorber les pics de productions, dont le développement du stockage, l’électrification de nos usages ou encore la flexibilité.
Flexibilité, électrification, stockage, où en sommes-nous ?
La flexibilité existe depuis toujours, c’est l’idée d’inciter les client⋅es à décaler leurs usages (lancer son lave-vaisselle, sa machine à laver ou encore recharger sa voiture) au moment de la journée où les centrales produisent le plus d’électricité. Cependant, les pratiques évoluent, et les heures creuses illustrent parfaitement l’évolution de cette « flexibilité » dans un contexte de développement des énergies renouvelables.
Les heures creuses historiquement nocturnes ont agi pendant longtemps comme signal prix pour décaler des consommations diurnes et ainsi limiter les effets de modulation de la production nucléaire. Aujourd’hui, ces heures creuses doivent s’adapter à d’autres modes de production et rediriger des consommations vers des créneaux plus adaptés. Dans ce nouveau contexte, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a acté la création de nouvelles heures creuses solaires dans la nouvelle mouture du TURPE 7 (2), qui entre en vigueur au 1er août 2025. Ainsi, à partir de novembre 2025, et progressivement sur le territoire, des plages d’heures creuses vont être déplacées en journée, pendant les pics de production solaire photovoltaïque (PV). Certains fournisseurs n’ont pas attendu pour se lancer. Enercoop est ainsi l’un des premiers à avoir lancé son offre flexibilité, Flexi Watt 2 saisons, avec des heures creuses en journée l’été. Octopus Energy a également lancé le Fan Club Octopus et propose de payer les kWh jusqu’à -50 %, quand les éoliennes à proximité tournent à leur maximum.
Quant au stockage, la France est en situation de rattrapage, mais le secteur connaît une croissance très rapide ces dernières années. Fin 2024, la capacité installée de batteries stationnaires a dépassé 1 GW, soit dix fois plus qu’en 2020, et plus de 7 GW de projets ont déjà réservé leurs droits d’accès au réseau, ce qui traduit une forte dynamique de développement. Selon les scénarios de RTE et de l’ADEME, la France pourrait avoir besoin de jusqu’à 13 GW de batteries à horizon 2050, selon le niveau de flexibilité de la demande et le développement des renouvelables. Les batteries sont aujourd’hui principalement utilisées pour l’équilibre du réseau électrique en temps réel, afin de lisser les pointes de production. A terme, l’idée serait d’encourager les batteries à soutirer de l’énergie précisément aux heures de forte production renouvelable, ciblant les zones où la production excède les capacités d’absorption du réseau, et en conditionnant le raccordement des batteries à une logique de consommation locale. Une évolution majeure qui permettrait que le stockage ne soit plus un simple réceptacle énergétique, mais un acteur proactif de l’équilibre du système électrique. L’évolution des capacités de stockage dépend davantage de l’amélioration des technologies existantes et du coût qu’elles engendrent, que d’adaptations sociétales. En guise de perspective sur l’intégration des batteries sur notre réseau, la Californie ou l’Australie sont par exemple en avance sur le sujet et pourrait nous en apprendre davantage.
Comment évoluent les mécanismes de soutien étatiques et sont-ils toujours indispensables ?
Si les énergies renouvelables se développent plus ou moins rapidement, c’est aussi en réaction aux mécanismes de soutien étatique. Si nous prenons l’exemple du photovoltaïque, son développement a été très soutenu depuis les années 2000 grâce à des tarifs d’obligation d’achat avantageux (EDF OA) et plus récemment grâce au décret tarifaire dit « S21 », adopté en 2021. Ce décret a été un véritable coup d’accélérateur pour le photovoltaïque en France. Le succès du dispositif est indéniable : entre fin 2021 et fin 2024, 16 GWc de demandes ont été enregistrées, bien au-delà des 4,8 GWc initialement prévues par la PPE 2.
Ces mécanismes de soutien étatique existent pour toutes les filières EnR, ce qui est indispensable pour impulser et faciliter leur déploiement. Mais la conjoncture économique actuelle oblige l’état à restreindre les dépenses publiques. Les arbitrages sont de plus en plus en défaveur des énergies renouvelables. A titre d’exemple, le gouvernement a annoncé pour 2025 une refonte du S21, devenu très faible sur les petites puissances, et en créant un nouveau système de passage en appel d’offres simplifié pour les plus grandes installations.
Toutefois, plus que la réduction des soutiens de l’Etat vis-à-vis des EnR, la vraie difficulté réside dans la vitesse d’exécution de ces baisses et la brutalité avec laquelle les décisions sont prises. En effet, si les soutiens de l’Etat servent à structurer une filière et soutenir de nouvelles technologies, le gouvernement peut légitimement questionner leur finalité, sachant que la filière PV est aujourd’hui structurée et que les coûts de production sont en baisse. Le sens de l’histoire va vers une diminution puis une fin des aides, signe d’un marché mature. Or, il est nécessaire de laisser à la filière le temps de passer outre ce désengagement de l’Etat. Les nouveaux modèles de valorisation économiques, tels que les PPA ou l’autoconsommation collective, sont en pleine phase de développement et reposent encore partiellement sur les mécanismes d’aides, en particulier dans les collectivités.
Les filières sont de plus en plus indépendantes mais pourront-elles faire face à l’augmentation des évènements extrêmes liés au changement climatique ?
Nous observons des impacts majeurs du changement climatique sur nos modes de production, mais c’est avant tout le nucléaire qui est particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. A titre d’exemple, lors des périodes de canicules telles que nous connaissons actuellement, certaines centrales sont mises à l’arrêt, pour éviter que l’eau utilisée dans le système de refroidissement des réacteurs ne soient rejetées à des températures trop élevées et impactent les milieux naturels. Associé à la sècheresse et la diminution du débit des cours d’eau que nous impose le réchauffement climatique, il deviendra de plus en plus difficile de produire de l’énergie nucléaire. Nos modes de production seront impactés et impacteront notre environnement.
Pour les énergies renouvelables, les périodes d’étiage impactent aussi les centrales hydroélectriques construites au fil de l’eau. Les pluies torrentielles et les inondations constituent également une menace pour ces installations. On observe également des baisses de rendement sur le solaire. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), la productivité des parcs solaires a décliné d’environ 5 % entre 2010 et 2020 dans certaines régions du globe, en raison de la pollution atmosphérique, qui réduit l’irradiation solaire disponible. Au global, l’accroissement des phénomènes climatiques extrêmes, qu’il s’agisse de canicules ou de tempêtes détruisant les lignes rendent plus compliquées l’exploitation et la maintenance des centrales de production et des réseaux, énergies renouvelables ou non.
En résumé, nous entendons souvent que notre électricité est déjà décarbonée. C’est vrai, grâce au nucléaire, mais notre mix énergétique lui ne l’est pas encore. Aussi, nous devons poursuivre nos efforts vers la décarbonation et l’électrification de nos usages. Et à ceux qui prônent l’investissement massif dans de nouvelles centrales nucléaires pour faire face au vieillissement de notre parc actuel, rappelons-leur que l’alternative offerte par les énergies renouvelables est une solution disponible immédiatement (là où l’installation de nouveaux réacteurs s’étale sur plus de 20 ans), créatrice de valeur sur les territoires, d’économies pour des milliers de Français.es, et que progressivement elles ne dépendront plus d’aucun soutien publique. Il est désormais urgent de se réapproprier notre énergie et de s’engager sur les chemins de la décarbonation, mais aussi et surtout de la sobriété énergétique, car notre pays aura certainement besoin des énergies renouvelables comme du nucléaire pendant encore quelques années.
Bertil de Fos et Margot Rat-Patron, ansi que les équipes d’Auxilia mobilisent leurs compétences en énergie et climat pour accompagner les collectivités dans la conception et la mise en œuvre de stratégies à la hauteur des enjeux. Contactez-les pour tout échange ou projet.
margot.ratpatron@auxilia-conseil.com
(1) La France n’a pas atteint la part de 23 % (seulement 19,1 %) d’énergies renouvelables dans sa consommation finale brute d’énergie en 2020, objectif issu de la directive européenne 2009/28/CE (paquet énergie-climat).
(2) Tarif d’utilisation des tarifs des réseaux publics de distribution d’électricité