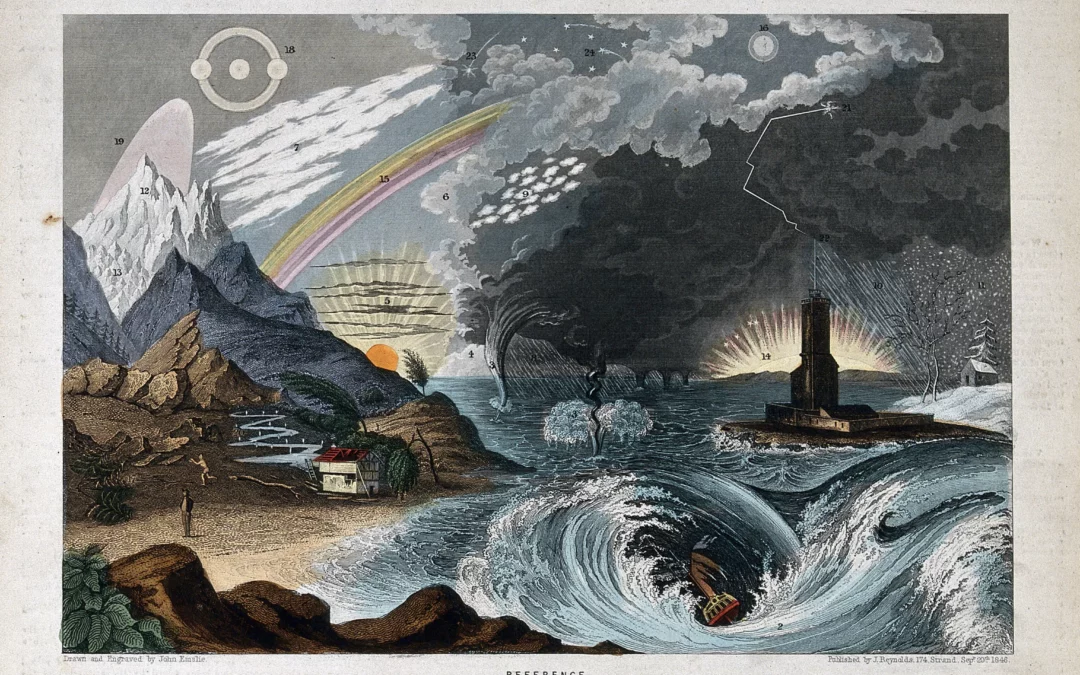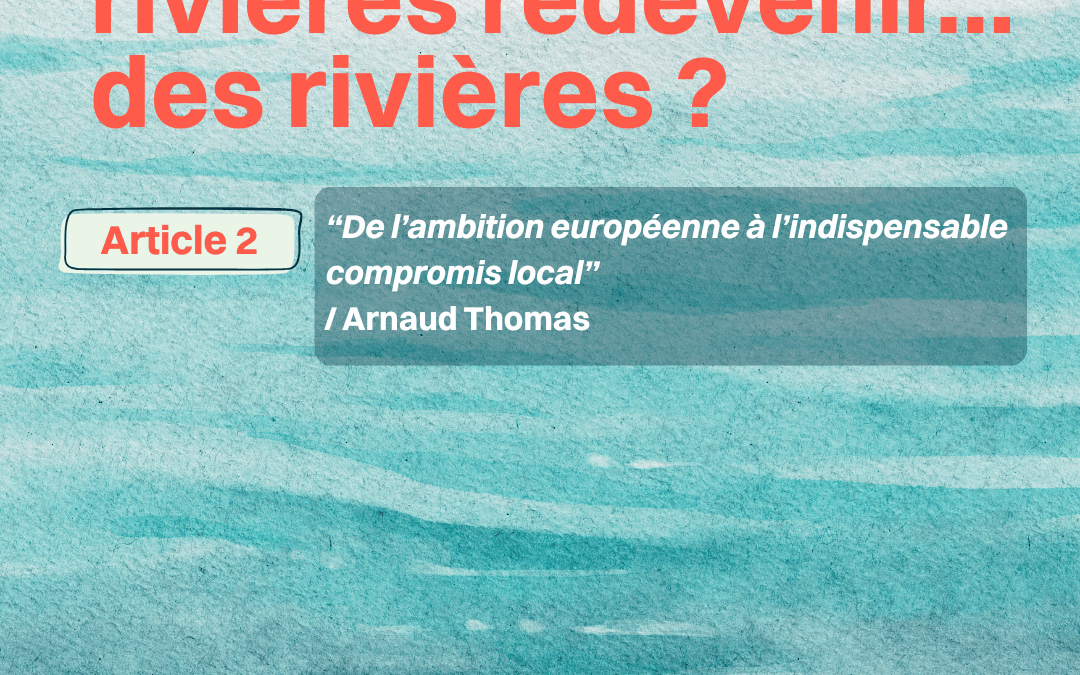Nous avons choisi de prendre la plume pour clarifier ce que nous entendons par participation citoyenne. Notre objectif est clair : donner à voir une vision vivante, juste et transformatrice de la participation citoyenne, valoriser une expertise de terrain ancienne mais rarement formalisée, et offrir un support à la fois interne pour fédérer nos méthodes, et externe pour partager nos convictions avec les collectivités.
Pourquoi écrire un manifeste sur la participation citoyenne ?
« La question de départ du manifeste, c’est bien pourquoi faire de la participation ? Beaucoup de collectivités se la posent aussi. Nous nous devions d’y répondre. »
Francesco Pirri, chef de projets Urbanisme
Le manifeste que nous avons produit est à la fois un plaidoyer et un guide. Un plaidoyer, parce qu’il porte haut nos convictions dans un moment où la participation citoyenne est parfois galvaudée ou instrumentalisée. Un guide, parce qu’il trace une voie pratique et réaliste, nourrie de notre expérience collective, pour celles et ceux – élus, techniciens, acteurs locaux – qui veulent faire de la participation un levier efficace de transformation. Et comme nous le rappelle Margot Rat-Patron, cheffe de projets Energie & climat « Les municipales sont le bon moment pour redonner aux citoyens du pouvoir dans les prises de décision. »
Concertation et participation citoyenne : une distinction à revendiquer
Ces deux termes souvent confondus présentent pourtant des réalités bien différentes. La concertation est un dispositif large, souvent à l’initiative des collectivités, qui réunit élus, techniciens, associations et habitants, les parties prenantes autour d’un projet. Elle permet d’échanger, d’expliquer, de débattre.
La participation citoyenne est plus exigeante, elle implique directement un groupe d’habitants dans la construction de la décision publique. Elle demande des moyens, du temps, un vrai cadre mais elle transforme durablement la relation entre institutions et citoyens. Idéalement, elle crée une culture du dialogue territorial et de la confiance, elle rend l’action publique plus juste et plus robuste, elle permet d’écrire des récits communs et de construire des ponts entre société civile et institutions, si elle soit « bien » menée.
Nos expériences le confirment : trop de dispositifs de participation sont réduits à des formats légers, consultatifs, parfois superficiels. Comme le souligne Amélie Pillet, cheffe de projets Energie & climat : « On a associé autour de la participation pleine de pseudo groupes de travail ou d’ateliers purement consultatifs qui génèrent beaucoup de frustrations. Frustrations chez les professionnels, les associations, les clients collectivités… et chez les rares habitants qui participent en confiance. »
Les démarches qui accompagnent sur le temps long des publics néophytes – tels que les jurys citoyens – restent rares, même dans des contextes qui s’y prêtent pourtant comme l’urbanisme ou la planification territoriale. C’est précisément là que réside la valeur de la participation citoyenne, dans sa capacité à dépasser la consultation pour véritablement partager la décision avec les acteurs et bénéficiaires principaux des projets de demain.
Ce qui rend l’approche d’Auxilia si singulière
En matière de participation citoyenne et en tant que cabinet de conseil en transition écologique, nous nous attachons à trouver le point d’équilibre entre expertise technique, rigueur méthodologique et attention humaine.
Notre approche repose d’abord sur une assise solide d’expertises thématiques – énergie, climat, urbanisme, économie circulaire, agriculture… – qui garantissent que chaque méthode d’animation est développée en lien avec les besoins thématiques, pour assurer compétence et accessibilité de l’information.
Cette technicité nourrit la pédagogie et la capacité de vulgarisation qui caractérisent notre équipe. Amélie insiste sur ce point : « On a cette capacité à vulgariser des sujets techniques parce qu’on les pratique au quotidien dans d’autres types de missions. » Autrement dit, notre force est de relier des expertises pointues à une mise en dialogue claire et accessible pour tous.
Notre approche se distingue aussi par le soin porté à l’animation. Chaque processus est pensé comme une rencontre exigeante et humaine. Francesco rappelle que « nous nous engageons sur le soin dédié à l’animation, à la préparation des animations, à la rencontre, au lien avec les citoyens ». Amélie ajoute : « On est très rigide sur notre rôle entre les élus et le groupe. […] On n’est pas dans l’instrumentalisation du groupe. On veille à garantir ce cadre, avec une loyauté forte vis-à-vis du groupe d’habitants qu’on anime. »
Enfin, une autre dimension est celle de l’acceptabilité sociale. Ce n’est pas seulement une méthode, mais une posture : considérer que tout projet doit intégrer la diversité des publics, leurs trajectoires et leurs vulnérabilités.
Assurer l’acceptabilité sociale : une posture et une méthode
Comme le souligne Christian Chatard, directeur de l’expertise Stratégie de territoires : « Ce qui nous caractérise, même si on n’arrive pas à mettre le doigt dessus, c’est le travail de l’acceptabilité sociale. On intègre une approche sensible des projets. On alerte les clients sur la prise en compte de différents publics et l’accessibilité des démarches pour assurer l’inclusivité des dispositifs. »
En somme, notre approche de la participation citoyenne consiste à créer des espaces où l’expertise rencontre l’expérience vécue, où les méthodes se mettent au service de la confiance, et où les citoyens trouvent réellement leur place dans la fabrique de l’action publique.
Créer des expériences participatives exigeantes et plaisantes à vivre
La participation citoyenne n’est pas qu’une question de bonnes intentions. Elle exige des méthodes solides et une attention constante aux conditions concrètes d’implication des habitants.
Nous nous appuyons sur des partenaires panélistes pour assurer un recrutement représentatif, garant d’ une diversité sociale et générationnelle. Mais au-delà de la représentativité, l’accessibilité est un point clé. Comme le rappelle Amélie : « On réfléchit à l’accessibilité géographique des ateliers, que ce soit accessible en transport en commun, qu’il y ait un ascenseur… qu’ils soient accessibles PMR, aux personnes pas véhiculées. » Cela concerne aussi les supports et la pédagogie : langage clair, facilitation graphique, photomontages, cartes postales, méthode FALC (Facile à Lire et à Comprendre). « On varie beaucoup les formats […]. On est vigilant à alterner les moyens d’expression comme le dessin, l’écrit ou l’oral », précise Margot.
Nous refusons également les formats convenus qui freinent ou découragent certains publics. Christian l’explique : « La salle aussi peut être stigmatisante. Il faut faire du plein air, de la balade, de l’événementiel, utiliser la culture, la musique… Se servir de tous les prétextes possibles pour rendre le sujet agréable. » Bref, le processus participatif doit être aussi plaisant à vivre qu’exigeant sur le fond.
Enfin, nous savons que la participation n’a de sens que si elle se prolonge au-delà des ateliers. Aussi nous travaillons à transférer nos méthodes aux agents et aux élus afin que la culture de l’écoute et de l’inclusion s’inscrive durablement dans les pratiques. Au final, les collectivités détiennent une responsabilité majeure : inscrire dès le départ dans les cahiers des charges des démarches des exigences fortes en matière d’accessibilité et de diversité.
Notre engagement est clair : créer les conditions de participation pour toutes et tous, en favorisant le dialogue territorial, en refusant les formats standardisés et en construisant des expériences à la fois exigeantes, accessibles et agréables.
Pour aller plus loin, lisez aussi l’article de Quentin Herbet, Vent de démocratie en Sarthe : une charte citoyenne pour l’éolien – Auxilia Conseil